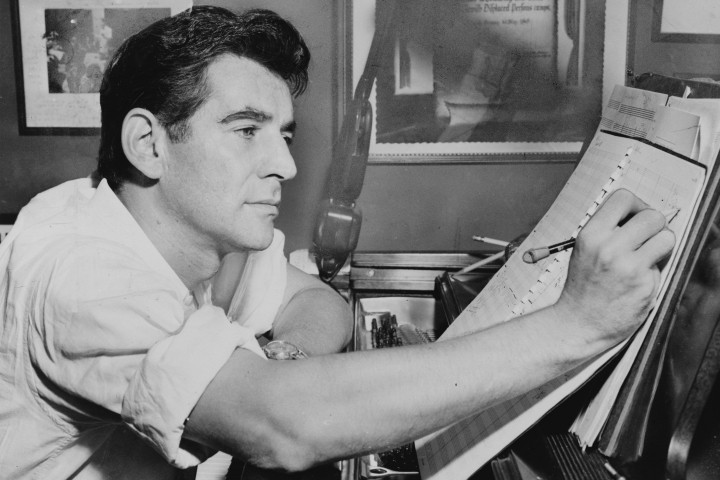C’est en Amérique du Nord que la louange prend un véritable et nouvel essor au XIXe siècle. Sa culture contemporaine prend racine dans celle des Pilgrims fathers, les « pères pèlerins », dissidents anglais fuyant l’Eglise anglicane. A bord du Mayflower, ils débarquent au Nouveau Monde en 1620, avec dans leur bagages les psaumes puritains (voir l’épisode 5, partie 2). Les premiers recueils publiés (en 1698 à Boston) compilent des airs européens ou des œuvres de musiciens européens émigrés, par exemple le fils du célèbre Johann Pachelbel, Charles Théodore Pachelbel (1690-1750). C’est ici qu’apparaissent deux dynamiques très différentes : celle des WASP (White Anglo-Saxon Protestant) et celle des esclaves afro-américains.
Dès le XVIIe, il est apparu la volonté d’instaurer une musique de qualité pour chacun, avec la création d’institutions pédagogiques musicales. Celles-ci permettent l’amélioration du niveau des amateurs qui étoffent les chœurs des églises. C’est ainsi que nombres des premiers compositeurs étasuniens sont avant tout des musiciens amateurs, motivés par leur sincère désir de créer pour Dieu et leur communauté. Tout en préservant leur tradition de chant religieux a cappella, les natifs de Nouvelle Angleterre « inventent un art spontané, efficace et émancipé du répertoire européen »[1]. Il est un événement incontournable de la pratique des protestants ruraux : les Camp Meetings. Les « Circuit riders », prédicateurs itinérants qui sillonnaient à cheval les grands espaces des Etats-Unis, animaient ces assemblées en plein air. Les milliers de participants y écouter les prêches et, surtout, chantaient.
On ne peut que citer le souvenir de Charles E. Ives (1784-1954), compositeur passionnant considéré comme le patriarche de la musique américaine : « L’homme « né côté du Babitt’s Coorner » est peut-être profondément attiré par les gospels simples mais intenses des « assemblées religieuses en plein air » de la Nouvelle Angleterre d’il y a environ une génération. Il y trouve – dans certains d’entre eux – une vigueur, une profondeur de sentiment, un rythme naturel proche de la terre, une sincérité profonde bien que peu artistique – qui, en dépit d’une sentimentalité criarde, le rapprochent davantage du « Christ du peuple » que ne le fait le Te Deum de la plus grande cathédrale. Ces airs-ci sonnent pour lui de façon plus authentique que ces hymnes (et motets) anglais ou néo-anglais, monotones, sans rythmes, sentant le renfermé, enseignés par des prêtres académiques – choses bien écrites, bien harmonisées, aux voix bien conduites, bien agencées contrapunctiquement, bien corrigées et bien réglées par un licencié en musique bien élevé, membre de la guilde royale des organistes – ces sons personnifiés, corrects et répondant aux habitudes de la vue et de l’ouïe ; en un mot, ces formes comme il faut qui ont la beauté d’un vitrail et auxquelles nos mécanismes sur-entraînés – les chœurs de garçons – se limitent. »[2]
Gianfranco Vinay commente : « Participer à l’un de ces Camp Meetings, quand la ferveur des chants était à son comble, constituait probablement une expérience excitante et bouleversante. Ives n’oublia jamais l’impression profonde que ces réunions champêtres exerçaient sur sa sensibilité musicale et sur son imagination, l’enthousiasme et l’admiration qu’il éprouvait pour la sincérité expressive de ces « mille âmes parlantes » qui chantaient « à leur manière », autrement dit, en altérant le texte et la musique par des improvisations et des interpolations. […] Ce goût de l’expression individuelle est issu de l’esprit de l’utopie démocratique américaine qui considérait la collectivité comme la somme des expressions individuelles. »[3]
Parmi les hymnes fréquemment chantés lors de ces réunions, on connaît encore bien aujourd’hui Nearer my God to Thee de Sarah Flower Adams (1805-1848), d’après le rêve de Jacob[4], ou In the Sweet Bye and Bye de Joseph P. Webster (1819-1875) sur un texte de Fillmore Bennett.
Nearer my God to Thee de Sarah Flower Adams, arrangé et interprété par la BYU Men’s Chorus.
Depuis l’arrivée des premiers africains en Virginie au XVIIe siècle jusqu’à la guerre de Sécession (1861-1865), de nombreux esclaves sont déportés dans les colonies d’Amérique du Nord pour travailler dans les plantations des colons. L’esclavage ne sera aboli qu’en 1865, après la guerre de Sécession. Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique leur a permis de préserver leur culture, leurs origines. Les noirs déportés n’ont pas pu emporter d’instruments. C’est donc de leur mémoire et de la terrible nécessité de s’accrocher à leurs croyances et expressions que ressurgissent des chants, des danses et probablement des instruments. Le peuple noir, en mélangeant des éléments musicaux hérités de l’Afrique avec des éléments empruntés et adaptés de la culture musicale blanche, va donner naissance à la plupart des genres de musique populaire actuelle nés au XXe siècle.
Les negro spirituals et les gospel songs, nés au XVIIIe siècle parmi les esclaves noirs des Etats-Unis, sont à l’origine des cantiques enseignés par les missionnaires blancs aux esclaves travaillant dans les plantations. Les esclaves se retrouvaient entre eux le dimanche, à l’église, seul moment où ils pouvaient échanger leurs sentiments. Ils ont transformé les hymnes européens à leur manière en y apportant des éléments propres à leur culture africaine.
Les spirituals s’inspirent essentiellement de l’Ancien Testament, les afro-américains s’identifiant au Peuple élu, à ses souffrances et à ses promesses de délivrance et de Salut.
Le Gospel, qui signifie Evangile (God Spell = Parole de Dieu), est plus joyeux, célébrant les écrits du Nouveau Testament. Majoritairement associé aux esclaves afro-américains, dans lequel ils ressentent fortement l’espérance de la délivrance promise par la naissance de Jésus et de son retour, le gospel est également fréquemment chanté lors des Camp Meetings et encore beaucoup aujourd’hui.
[1] SOUTHON Nicolas, Les symphonies du Nouveau Monde, Fayard/Mirare, 2014, p.21.
[2] IVES Charles, Essays Before a Sonata. The Majority and other Writings, New York: The Norton Library, 1970, p.66-67.
[3] VINAY Gianfranco, Charles Ives et l’utopie sonore américaine, Michel de Maule, 2001, p.45.
[4] Genèse 28.11-12 : « [Jacob] arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. »
[5] Texte inspiré de l’Exode 7-11.