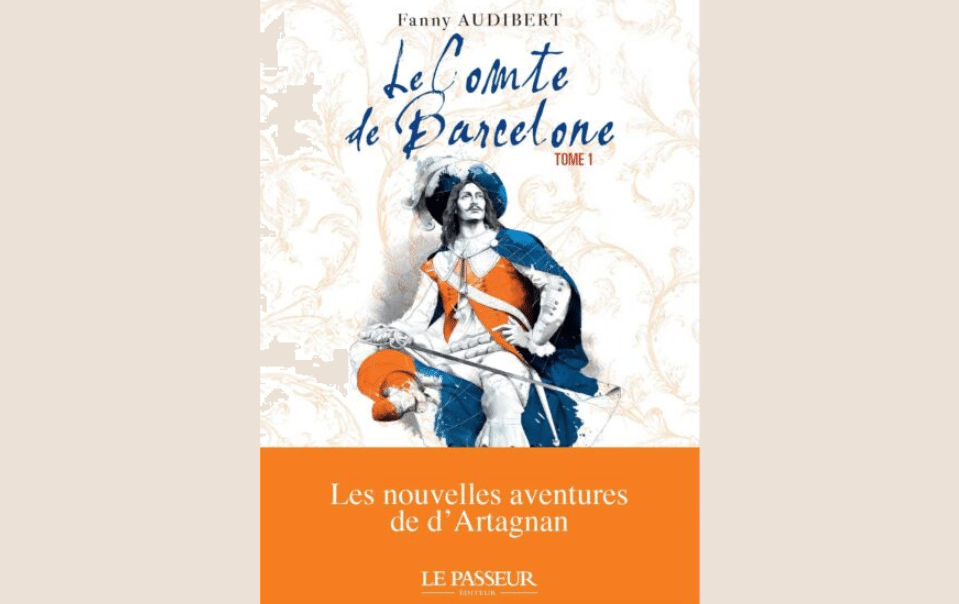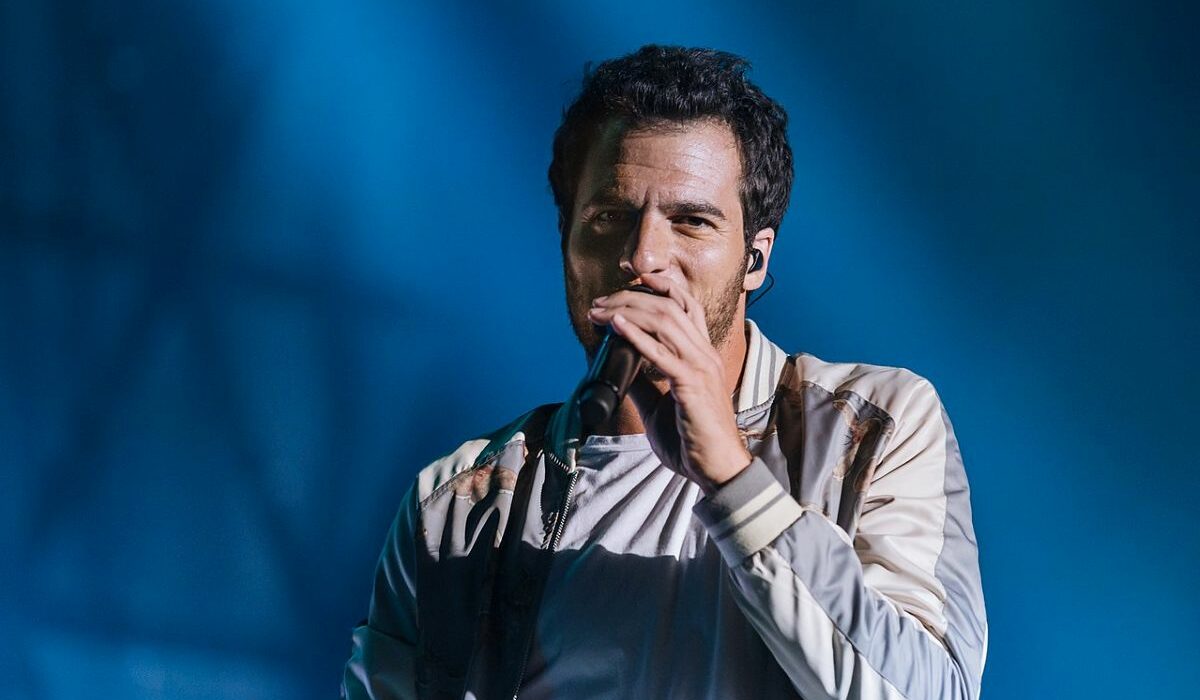La voie de l’organisation et du bon ordre de la cité est de donner à chaque classe de citoyens ce qu’il convient. L’essentiel est que chacun soit formé dans ce qui lui est inné, et il convient d’éviter ce qui n’est pas en lui de nature. Le point de départ est le principe platonicien : la vertu est l’excellence dans sa fonction propre[1]. Les instances de gouvernement, organisatrices de la vie de la cité, devront interroger la fonction (ergon) propre de chaque individu ainsi que sa capacité (dunamis) à accomplir cette fonction ; car c’est uniquement dans la mesure où les fonctions propres et capacités de chacun seront respectées que le bon ordre pourra régner. Chaque citoyen doit s’individualiser dans un seul métier, s’y attacher et ne pas en changer. En rejoignant le principe platonicien, Fārābī déclare donc qu’il doit être confié à chaque habitant de la cité un seul art, auquel il se consacrera soit dans le rang de la servitude, soit dans le rang de la souveraineté, sans jamais outrepasser ce rang[2]. C’est en effet à l’intérieur de ces deux rangs que nous retrouvons les trois classes de la cité ayant chacune une fonction propre. La vie des citoyens de chaque classe est réglementée, selon la fonction de cette classe et le naturel de ses membres.
La première des classes est celle des producteurs. Cette classe, loin d’être dévalorisée, est d’une importance capitale puisque c’est elle qui assure la subsistance matérielle de la cité, en fournissant aux autres citoyens tout le nécessaire : nourriture, boissons, habitations, vêtements, etc. La fonction des producteurs est vitale et ils doivent s’y adonner sans restriction ; pour cela ils ne doivent pas vivre dans l’opulence, laquelle les porterait vers l’abandon de leur ouvrage, ni dans la pauvreté qui les couperait de l’excellence du travail par la difficulté de leur propre acquisition de ce dont ils ont besoin pour l’accomplir correctement. Voilà comment cette classe s’apparente au foie dans le corps humain et à la faculté appétitive de l’âme humaine ; et, de ce fait, elle est subordonnée aux deux autres.
La deuxième classe est celle des gardiens, qui ont une fonction triple à en croire le pseudo al-‘Āmirī : « Il faut que les gardiens sachent qu’ils gardent la cité des ennemis extérieurs à elle, qu’ils la gardent des maux qui sont en elle, et qu’ils en gardent également les lois.[3] » Ils sont donc protecteurs de la cité sous trois aspects, extérieur, intérieur et légal. La classe des gardiens s’apparente au cœur dans le corps et à la faculté irascible de l’âme. À cet égard, les gardiens représentent la vertu de courage, placé dans le cœur. Ils ne sont pas pour autant l’organe dirigeant premier de la cité, comme le cœur l’est dans la théorie cardio-centriste. En tant que gardiens de la cité, ils sont eux-mêmes subordonnés à la troisième et dernière classe, celle des dirigeants, associée au cerveau et la faculté rationnelle. Cette troisième classe est celle sur laquelle se concentre la majeure partie des réflexions des philosophes musulmans, la thématique du gouvernant vertueux ayant donné lieu à une littérature conséquente[4].
Cette classe de gouvernants se divise à son tour en deux : d’une part le prince, gouvernant premier, chef ultime de la cité ; et, d’autre part, les savants, gens de la sagesse, qui gravitent autour du pouvoir et le conseillent. C’est cette classe, et principalement son chef, qui va être en mesure de déterminer la nature et la fonction de chaque citoyen puisqu’elle possède les connaissances nécessaires à cette répartition. C’est ici que l’on retrouve l’idée de la science politique comme art ou teknè. En effet, le gouvernant suprême et ses conseillers doivent posséder une somme de savoirs conséquente, concernant la nature humaine, les différents caractères et tempéraments de l’âme, les règles de bonne conduite morale, les arts de gouverner – faire ou éviter la guerre, faire prospérer la cité, conduire les citoyens sur le droit chemin en termes de mœurs, etc. Le gouvernant doit être ainsi juste, savant, vertueux et bienveillant envers ses sujets.
« [Le gouvernant], dit Anūširwān, doit se distinguer par la vertu ; [il doit] avoir une intelligence authentique et disposer de vivacité d’esprit ; l’adversité ne doit pas le déconcerter […]. Il ne doit pas précipiter une affaire avant que son heure ne soit venue, ni la retarder après son heure ; Il doit connaître la loi, être éclairé dans les conduites politiques, apprécié des gouvernés, impénétrable quant à sa véritable manière de penser ; il doit user de patience dans la réflexion, connaître les affaires qui vont et qui viennent […], et être savant dans les catégories d’individus, leurs rangs et leurs situations […].[5] »
Cette idée apparait dans la pensée musulmane derechef au travers de l’influence platonicienne. La République, on s’en souvient,envisage la politique quant à son usage : le philosophe-roi gouverne une cité à l’intérieur de laquelle il rend les citoyens savants et vertueux, en les contraignant à n’accomplir que leur fonction propre. La politique est une technique[6](teknè) et le philosophe est celui qui en use le mieux. Elle n’est plus seulement une compétence savante, elle devient la pièce maîtresse du rassemblement de toutes les techniques dans la cité et elle est alors épitactique, car elle s’exerce en vue de l’action. La politique est même la seule science qui produit son objet -la cité -et son usage -elle la gouverne. Vu sous cet angle, le gouvernant est alors l’artisan politique par excellence, celui qui rassemble des éléments distincts pour produire une unité. Selon Miskawayh :
« [Le gouvernant a] le devoir d’orienter chacun vers le bonheur qui lui est propre. Dans l’intérêt et la sollicitude qu’il porte à ses administrés, il aura ainsi à faire deux parts : d’un côté, il visera à les bien orienter et diriger au moyen des sciences discursives ; de l’autre, à les orienter vers les métiers et les travaux concrets.[7] »
De plus, le gouvernant est celui qui est en mesure de pratiquer un triple gouvernement. Le pseudo al-‘Āmirī explique ce point en se référant encore une fois à Porphyre, qui aurait déclaré que celui qui mérite de gouverner est celui qui est d’abord capable de mener ses propres affaires, celles de son foyer selon la bonne manière[8].Il ajoute que l’artiste véritable est celui qui est en mesure d’élever son art au plus haut degré de perfection, et le gouvernant doit s’efforcer de faire de même dans son art propre.
La division tripartite que nous venons d’expliciter sommairement, révèle maintenant sa grande importance : elle est garante de la bonne marche de la cité, elle doit donc être respectée et tout doit être fait pour qu’elle perdure. Cette division permet de construire la cité sur la base du naturel des citoyens ; et la politique est une science productrice, non pas d’une normativité imposée aux citoyens, allant à l’encontre de leur bonheur, mais d’un ordre respectant l’individu dans sa particularité et garantissant l’harmonie dans la cité. La cité est ainsi un ensemble, l’unité d’une multiplicité hétérogène ; et c’est une telle unité en tant que fin qui donne à la politique sa fonction.
[1]PLATON, La République, tr. G. Leroux, Paris, Flammarion, 2002, 352e-353a.
[2]AL-FARABI, Aphorismes choisis (Fuṣūl Muntaza’a), tr. fr. S. Mestiri & G. Dye, Paris, Fayard, 2003, p. 92.
[3]AL-‘ĀMIRĪ (pseudo-), Kitāb al-Sa‘āda wa l-Is‘ād, éd. M. Minovi, As-Saʽādah waʾl-isʽād (On Seeking and Causing Happiness) written by Abūʾl-Ḥasan Muḥammad al-ʽĀmirī of Nēshābūr (992 A.D.). Facsimilé d’une copie préparée par M. Minovi, Wiesbaden, 1957-8, fol. 404. Pour en savoir plus sur cet ouvrage, voir le billet https://blog.regardsprotestants.com/carnetsduneetudianteentheologie/sujet-de-doctorat/
[4]Il convient de préciser que le pseudo al-‘Āmirī n’énumère pas trois mais quatre classes : celle des dirigeants et des sages, celle des gardiens, celle des kuttāb (scribes) et enfin celle des producteurs. La classe des scribes n’apparait pas chez Platon, même si elle peut être reliée à la première classe. Cet ajout souligne selon nous deux choses : tout d’abord l’importance de cette fonction de kuttāb dans la société musulmane de l’époque, fonction que l’auteur énumère à part comme pour insister sur sa place et son rôle. Puis, cela souligne également les réflexions menées par les penseurs musulmans pour fusionner l’influence grecque avec les spécificités de leur culture islamique.
[5]AL-‘ĀMIRĪ (pseudo-), Kitāb al-Sa‘āda wa l-Is‘ād, fol. 425-6.
[6]PLATON, La République, I, 373e-375a.
[7]MISKAWAYH, Traité d’éthique (Tahḏīb al-Aẖlāq wa ṭathīr a-A’rāq),tr. fr. M. Arkoun, Paris, Vrin p. 117.
[8]AL-‘ĀMIRĪ (pseudo-), Kitāb al-Sa‘āda wa l-Is‘ād, fol. 192.