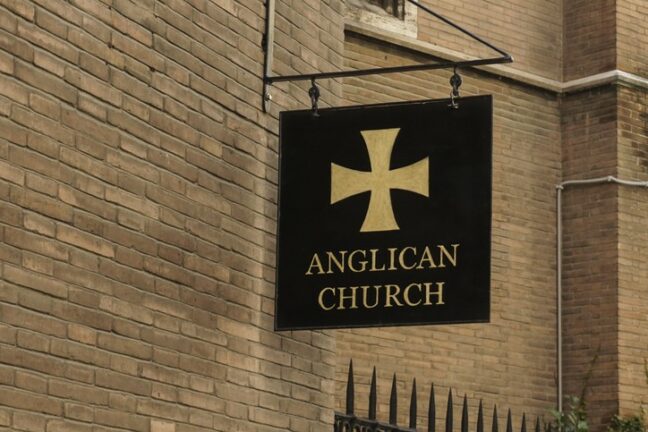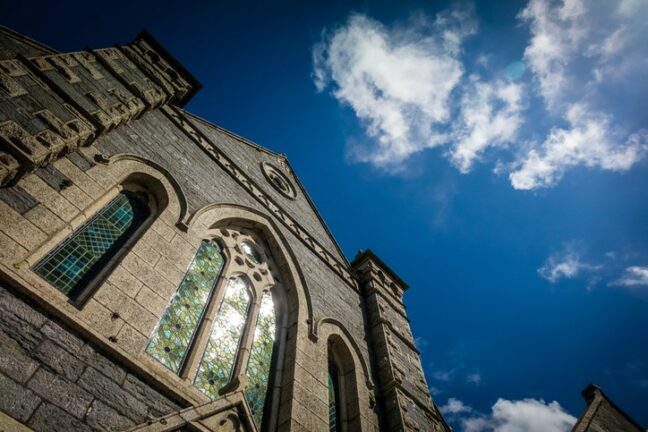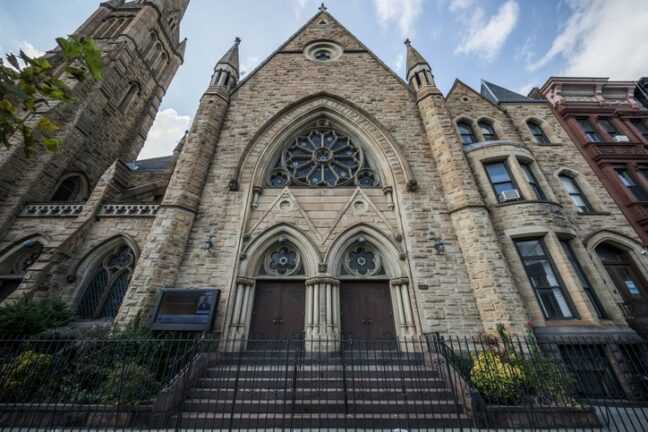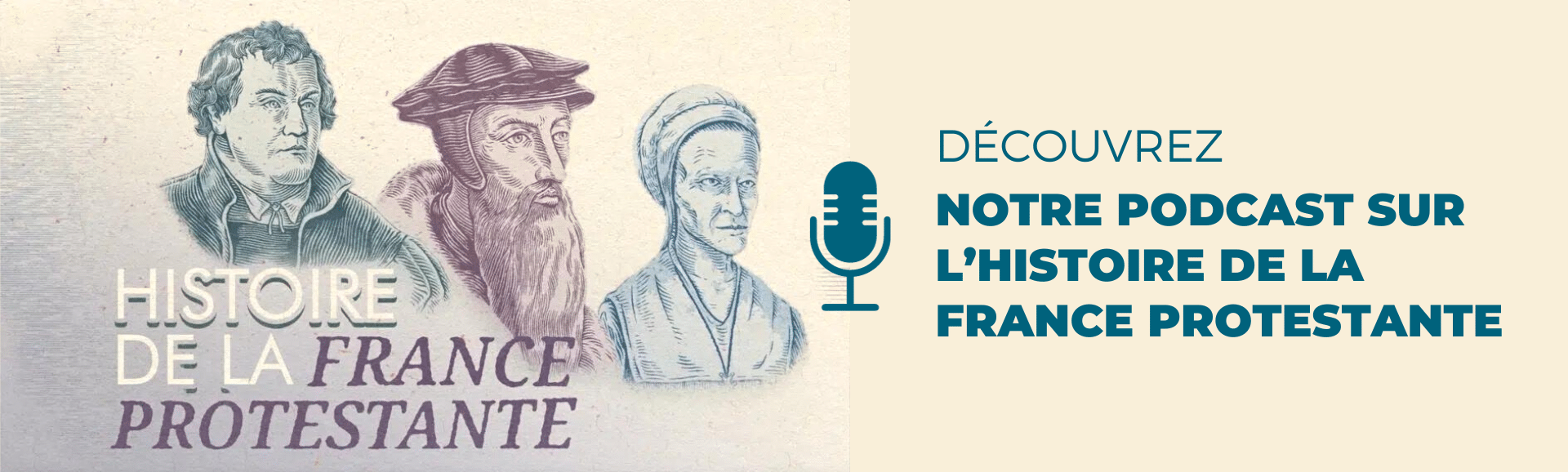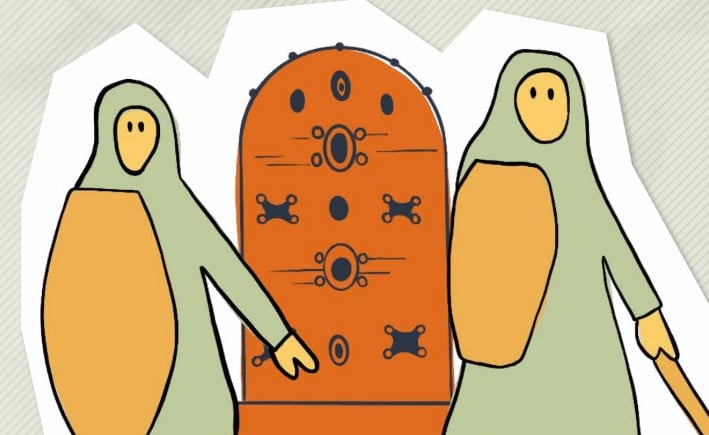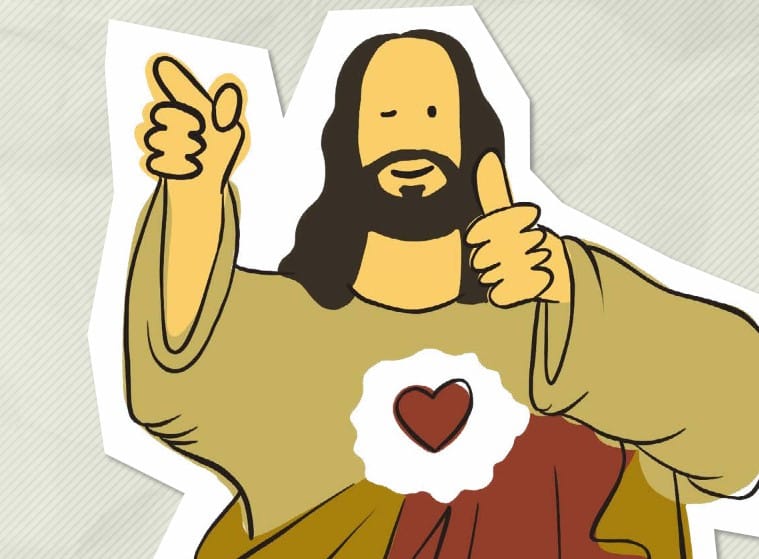L’émergence de la Réforme
Dans la présentation de la confession d’Augsbourg qui est un des livres fondateurs du luthéranisme, son ami Philip Melanchthon a écrit : « Je n’ai pas eu le dessein d’introduire une opinion nouvelle, mais d’exposer, d’une manière claire et convenable la doctrine “catholique“ qui est enseignée dans nos églises et qui a été mise en lumière par le docteur Martin Luther pour purifier et réformer l’église. »
Tout occupé à mener le combat dans le domaine des idées, Luther a laissé une importante œuvre écrite. Si l’on considère les transcriptions de ses discours, on compte plus de six cents titres. Cela lui a laissé peu de temps pour s’occuper de l’organisation de l’Église et ce sont les princes acquis à sa cause qui se virent confier la direction des communautés et un rôle de surveillance.
Dans le Saint-Empire romain germanique, l’émergence de la Réforme a suscité des oppositions qui ont entraîné un certain nombre de guerres entre les États luthériens et catholiques. Elles se se sont conclues par la paix d’Augsbourg en 1555 qui repose sur le principe fondamental cujus regio, ejus religio (tel prince, telle religion). Ce principe induit que c’est celui qui possède le territoire qui détermine la religion. Il y aura ainsi des États et des villes protestantes dans l’empire, et des catholiques. Les sujets qui sont en désaccord avec la religion de leur suzerain ont toujours la possibilité d’émigrer. Ce traité a donné une reconnaissance légale au protestantisme, et il a donné naissance à ce qu’on a appelé la réforme « magistérielle » en ce qu’elle s’appuie sur les magistrats et les théologiens.
Les grands principes du luthéranisme
Dans la grande diversité des protestantismes, le luthéranisme se distingue par trois inflexions.
La doctrine des deux règnes propose une distinction entre le règne temporel du monde qui est régi par la loi et qui est sous l’autorité du magistrat, et le règne spirituel de l’Église régi par la grâce. Ces deux règnes dépendent de Dieu, mais ils induisent une séparation des domaines d’intervention. Dans l’histoire, cette doctrine a parfois conduit les luthériens à avoir une attitude plutôt passive vis-à-vis des pouvoirs politiques. Cette position est à nuancer, car quiconque a bien lu Luther ne peut prendre son parti ni du mensonge ni de l’oppression ni de l’injustice, mais il le fait en tant que citoyen.
Une sensibilité aux sacrements. Au seizième siècle, luthériens et réformés ont essayé de se rapprocher lors du colloque de Marbourg en 1529 auquel ont participé Luther et Zwingli. Une liste de quinze questions était à l’ordre du jour. Les deux réformateurs se sont mis d’accord sur quatorze d’entre elles, mais ils n’ont pas réussi à s’entendre sur le dernier point qui concerne la cène. Les luthériens ont adopté une position intermédiaire entre la doctrine catholique de la transsubstantiation et la doctrine réformée de la présence spirituelle. Pour les luthériens, le pain et le vin de la cène restent pain et vin tout en étant réellement corps et sang du Christ.
Un engagement fort dans le dialogue avec l’Église catholique. Les luthériens ont toujours été à la pointe du dialogue œcuménique et c’est avec eux qu’a été signé en 1999 le texte majeur de la déclaration commune sur la justification par la foi, thème qui est à l’origine de la découverte réformatrice. Par la suite, les réformés et les anglicans ont rejoint cet accord.
Ces différences soulignent la sensibilité luthérienne, mais elles ne sont pas séparatrices d’avec le reste du protestantisme. Les Églises luthériennes et réformées d’Europe ont signé en 1973 la concorde de Leuenberg qui a établi une « pleine communion de chaire et d’autel », c’est-à-dire dans les domaines de la prédication et des sacrements. Cette concorde a rendu possible la création en 2013 de l’Église protestante unie de France.
Les luthériens dans le monde et en France
Historiquement, les pays où les luthériens sont majoritaires sont le nord de l’Allemagne, les pays scandinaves (Islande, Norvège, Danemark, Suède) ainsi que la Finlande et l’Estonie. Grâce à l’immigration allemande et scandinave, le luthéranisme s’est développé au XIXe siècle aux États-Unis, pays dans lequel il compte aujourd’hui 8 millions de fidèles. Puis il s’est répandu dans les pays du sud. C’est aujourd’hui en Afrique qu’il connaît la plus forte croissance.
En France, les luthériens sont surtout présents en Alsace et dans le pays de Montbéliard. Ils sont difficiles à dénombrer, car de nombreux luthériens fréquentent des églises unies. On estime qu’ils sont entre 200 000 et 250 000.
Dans le monde, les luthériens sont entre 65 et 70 millions, soit un peu moins de 10% des protestants. La plupart des Églises sont rassemblées dans la Fédération luthérienne mondiale qui contribue à renforcer l’identité des luthériens à travers le monde.