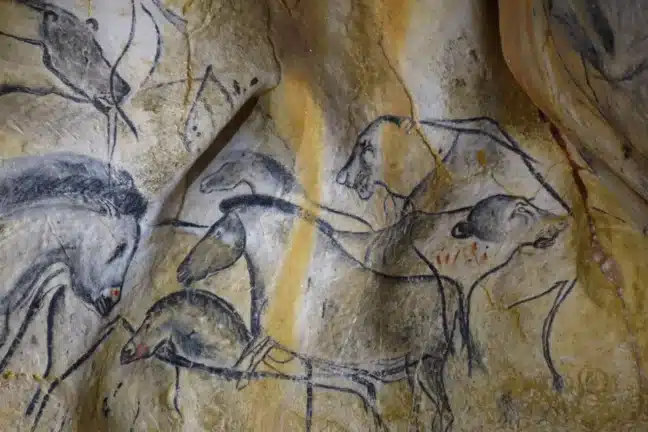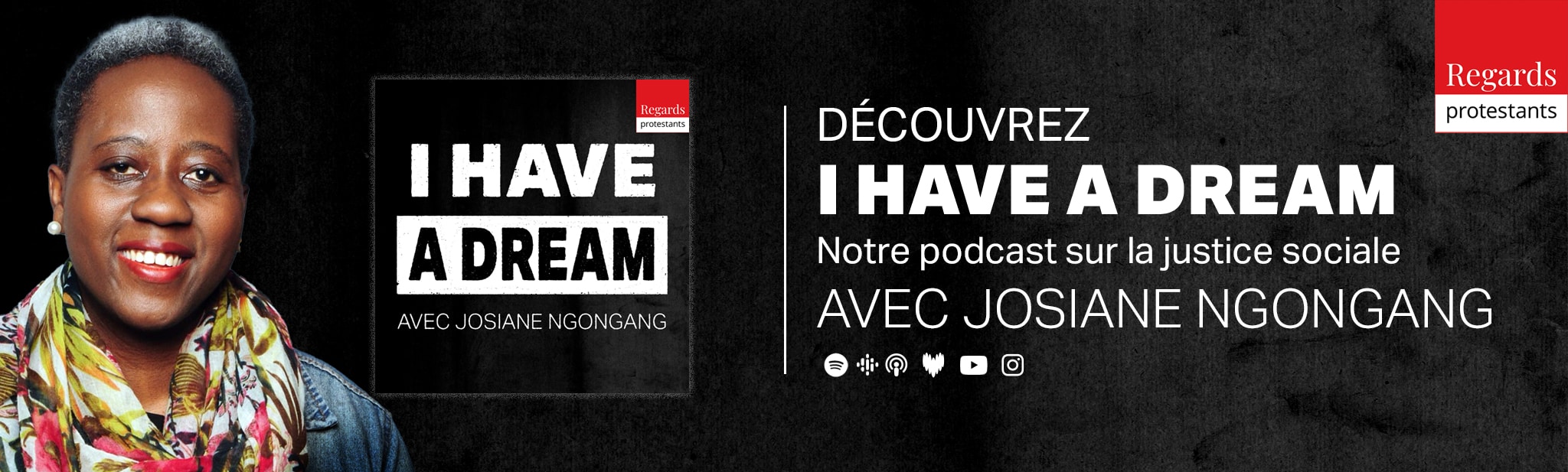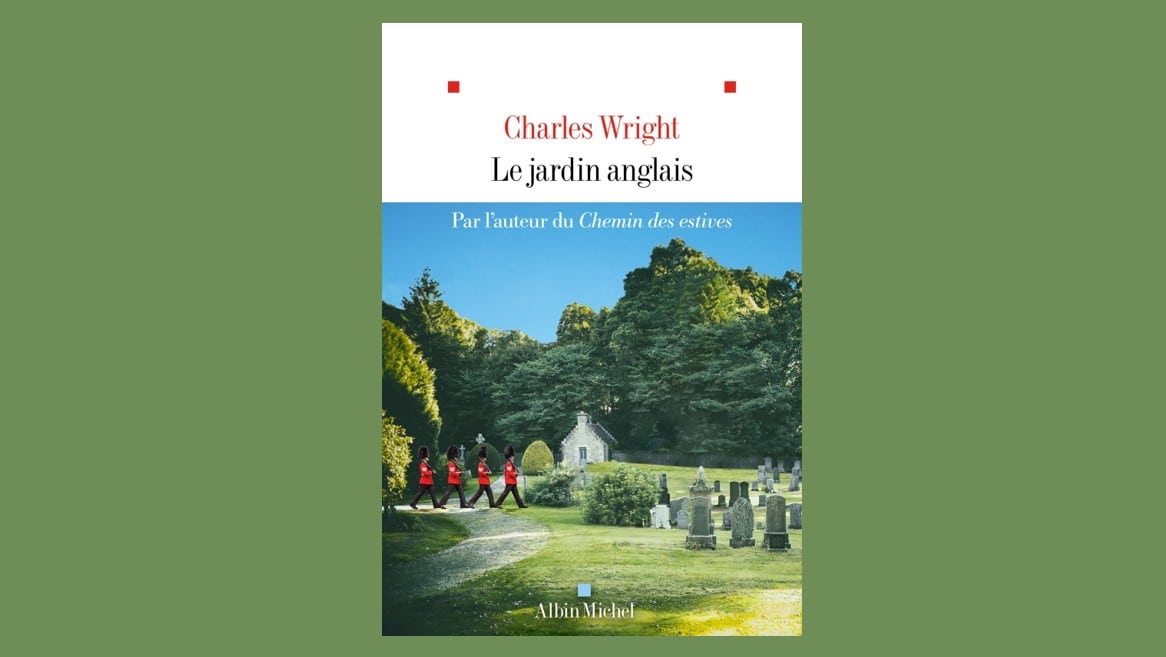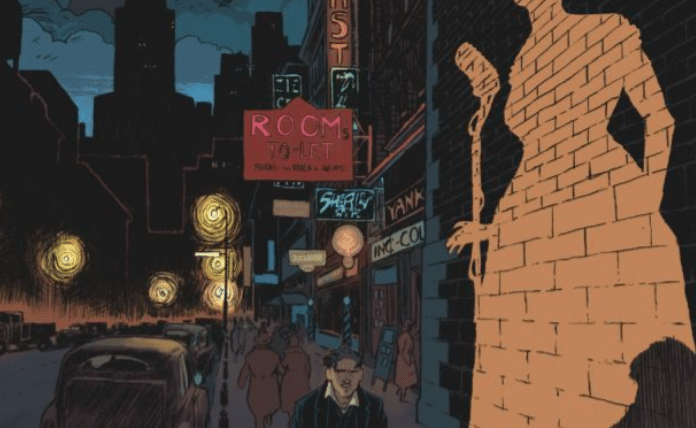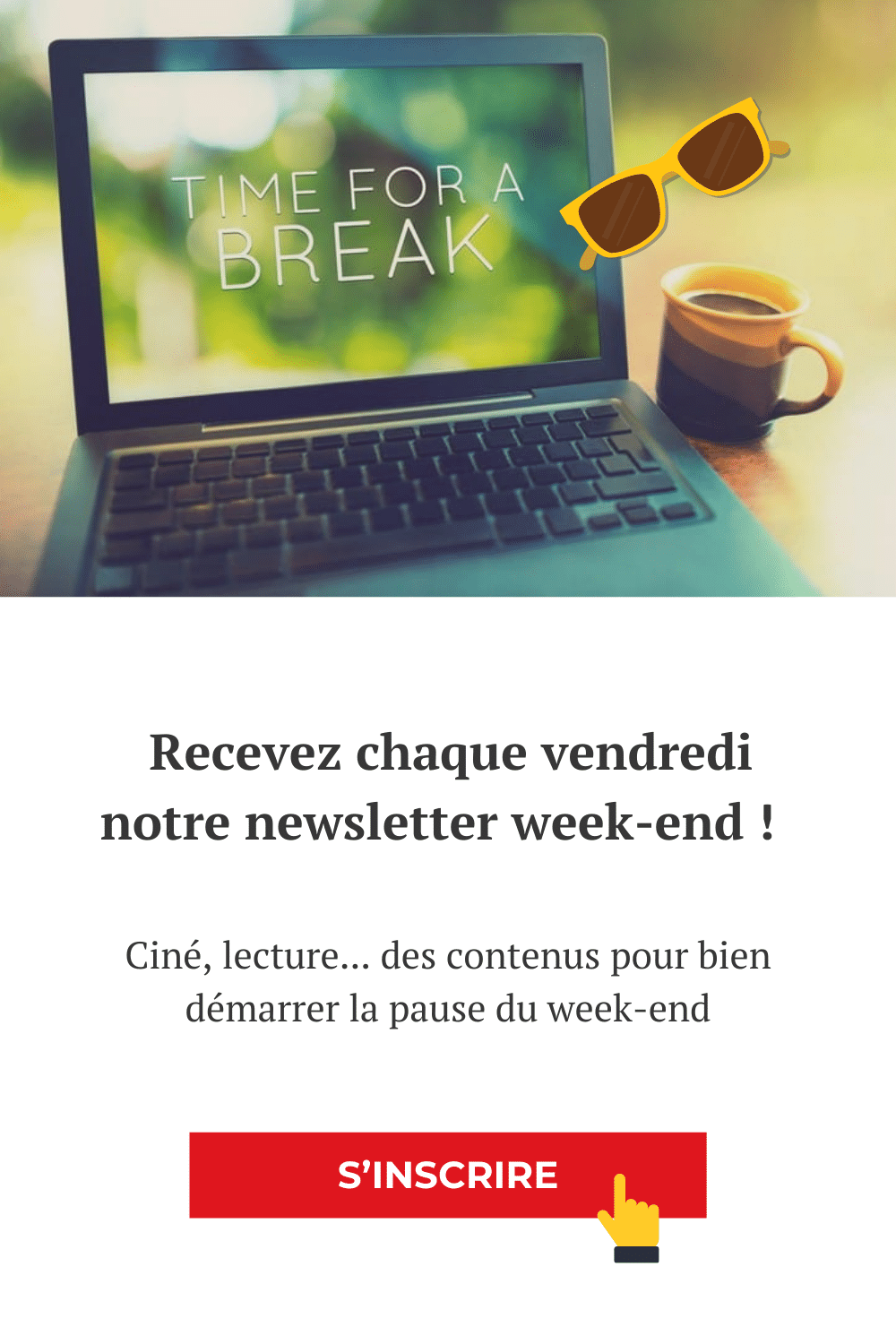Le projet de loi sur la fin de vie, actuellement débattu à l’Assemblée nationale, prévoit de légaliser l’aide à mourir en France. Ce texte divise profondément l’opinion publique et soulève de nombreuses questions éthiques. Ce projet de loi actuellement en discussion veut encadrer ce qu’on appelle « l’aide à mourir », avec des conditions précises d’accès. Patrick Récipon, président du Réseau Vie, nous aide à mieux comprendre le projet de loi sur la fin de vie et ses enjeux.
Lorsqu’un pays légalise ce que l’on appelle l’euthanasie, même en promettant des garde-fous stricts et un encadrement rigoureux, l’expérience montre que ces limites s’assouplissent avec le temps. En Belgique par exemple, les dérives sont apparues progressivement et le recours à l’euthanasie a fortement augmenté quelques années après l’adoption de la loi, même auprès des adolescents qui vivent de grosses déprimes.
Les critères d’encadrement de l’aide à mourir proposés dans ce projet de loi sont critiqués par certains, les jugeant trop larges et risqués.
Légaliser l’aide à mourir ferait peser un fort risque de confusion et de perte de confiance entre patients et soignants, en particulier en fin de vie, où la vulnérabilité est grande. Lorsque le patient verra un soignant entrer dans sa chambre, il se demandera s’il vient pour le soigner ou pour lui proposer ou lui donner la mort. Face à la fatigue des proches et au sentiment d’être une charge, certains malades pourraient se sentir implicitement poussés à choisir la mort, faute d’un accompagnement humain et bienveillant.
L’Ordre des médecins est défavorable à cette loi, estimant qu’elle va à l’encontre de leur vocation, qui est de soigner et non de donner la mort.
On le comprend bien, ce texte pose des questions médicales mais aussi plus larges : quelle vision de la vie, de la mort ? Ce texte, selon ses auteurs, vise à donner plus de liberté aux patients.
Il est très facile d’avoir de belles idées sur la fin de vie lorsqu’on est en pleine forme, mais la réalité vécue par les personnes malades est bien différente. Contrairement à ce que l’on croit, les gens en fin de vie veulent vivre. Ce décalage entre les discours tenus en pleine santé et les besoins réels en fin de vie souligne l’importance d’un accompagnement humain, notamment en EHPAD, où les risques de dérives sont réels.
Selon l’article 6 du texte actuellement examiné, un décès provoqué par une aide à mourir serait enregistré comme une « mort naturelle » sur le certificat de décès.
Nous sommes dans le mensonge. Le mensonge est devenu une composante inquiétante de notre société, notamment lorsqu’on qualifie de « mort naturelle » un acte de suicide assisté, ce qui revient à nier la réalité de la mort donnée. Le mensonge est très caractéristique des lois mortifères. Cela ouvre la porte à de graves dérives où l’acte de tuer risquerait d’être banalisé ou légitimé.
La question de la fin de vie reste complexe. Il semble toutefois possible de soulager la souffrance, sans pour autant franchir une ligne éthique.
Il est essentiel de poursuivre les recherches et de renforcer les soins palliatifs, car aujourd’hui, la douleur peut être soulagée dans la quasi-totalité des cas. Ce qui fait défaut, ce sont surtout les moyens matériels et un accompagnement humain, comme le souhaitent la majorité des patients en fin de vie.
Un podcast de Phare FM.