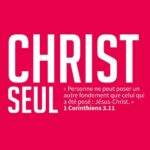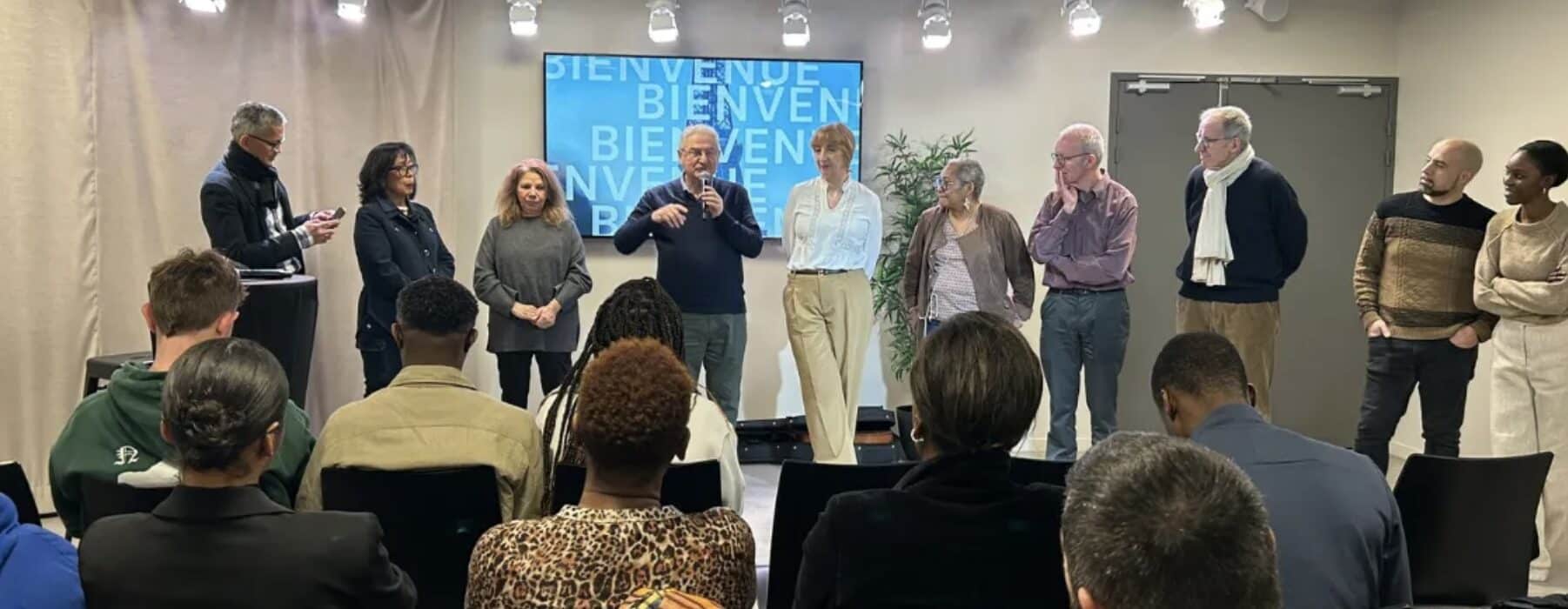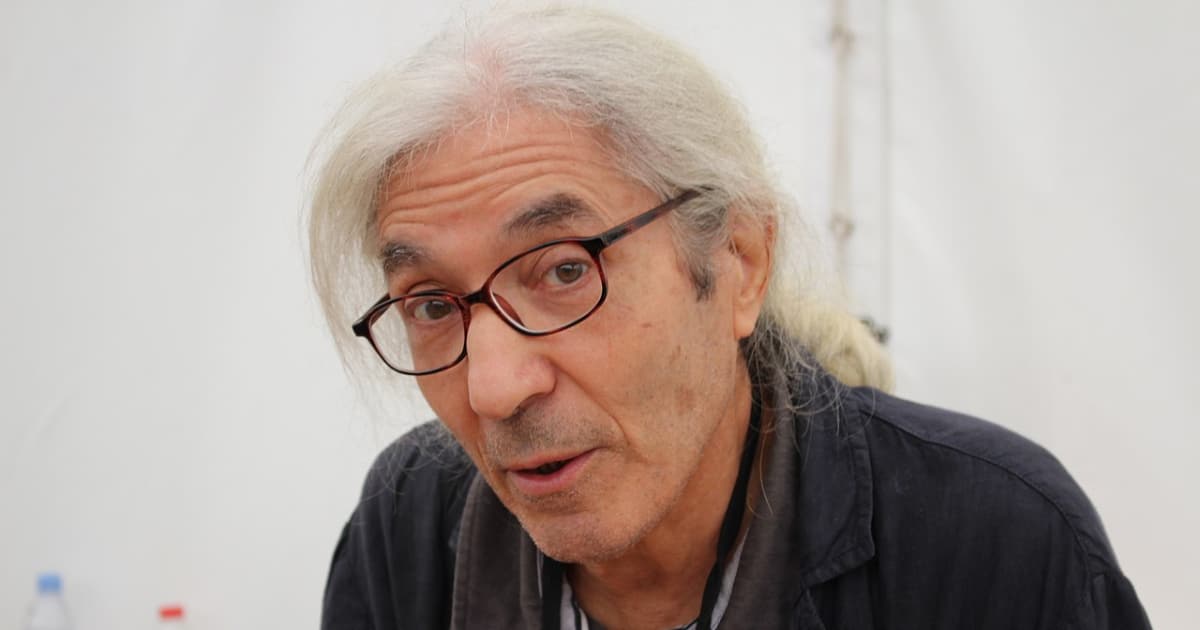Les Réformateurs voulaient en corriger la théologie, les abus, les institutions, mais conservaient la structure existante d’une société chrétienne : un Corpus christianum, une chrétienté, composée de saints et surtout de pécheurs, et soutenue par une autorité séculière. L’historien G. Williams a qualifié cette option de « Réforme magistérielle ». À cette dernière, il opposait une « Réforme radicale » dans laquelle les communautés étaient séparées de l’État. Du Corpus christianum se détachait le Corpus Christi – Corps du Christ (1Co 12.27) –, composé de « croyants engagés », la communauté des disciples de Jésus. « La Réforme radicale désigne classiquement cette branche de la Réforme protestante qui, au 16e siècle, a choisi de couper les ponts avec la société de chrétienté. »
Cette appellation de Réforme radicale est cependant contestée, parce qu’elle attribue à une diversité de mouvements une unité qu’ils n’avaient pas : spiritualistes, révolutionnaires, millénaristes, rationalistes, et aussi les… anabaptistes.
Ces derniers étaient néanmoins porteurs d’une radicale réforme de l’Église et de la vie chrétienne :
1. Par leur aspiration à revenir à la racine (radix en latin) de la foi chrétienne : pour les premiers anabaptistes, la vie chrétienne ne s’origine ni dans l’appartenance à une société ni dans un rite (le baptême d’enfant), mais dans […]