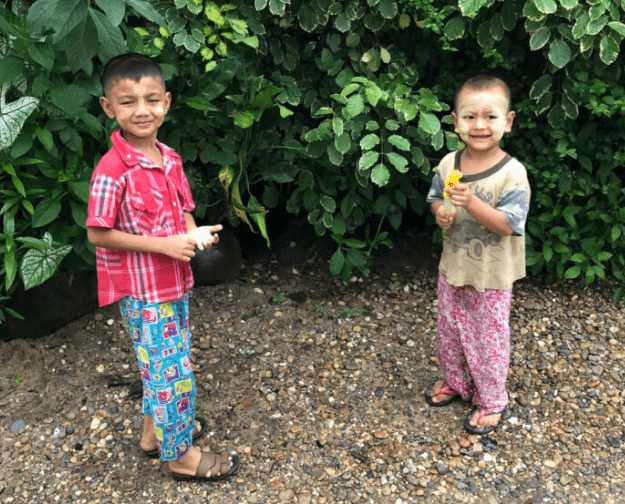Ecoutons Aristote :
« Si, en effet, chaque instrument était capable, sur une simple injonction, ou même pressentant ce qu’on va lui demander, d’accomplir le travail qui lui est propre […], si, de la même manière, les navettes des métiers à tisser tissaient d’elles-mêmes, […], alors, ni les chefs d’artisans n’auraient besoin d’ouvriers, ni les maîtres d’esclaves ».
De façon spectaculaire, ce rêve d’abolition du travail humain ne signifierait pas pour Aristote l’abolition de l’humanité. Car, pour lui, le travail n’est pas une nécessité de la nature humaine, elle est seulement une activité humaine (energeia) possible parmi beaucoup d’autres. Lui-même, aristocrate, avait des activités innombrables, il avait créé la logique, la rhétorique, les sciences naturelles, la science politique, il était mathématicien et astronome, conseiller politique et précepteur d’Alexandre le Grand… Mais il ne travaillait pas. Au sens propre, nous pourrions dire, reprenant une distinction plus classique en latin entre « labor » et « opus », qu’il « œuvrait ».
Non seulement l’activité de travailler n’est pas le propre de l’humanité selon Aristote mais elle lui paraissait même contraire à sa nature en transformant l’individu esclave ou salarié en moyen de production. L’esclave ? Une « propriété animée » et tout homme au service d’autrui, est « un instrument qui tient lieu d’instrument», disait Aristote. » Au même titre que les animaux et les outils comme il le note dans les Economiques.
En accord sur ce point avec les sophistes, la nature humaine est d’une toute autre nature. Elle exige pour se réaliser du temps libre et une indépendance d’esprit ce qui est contraire au statut d’esclave ou de salarié. Dans ce rêve, si les machines accaparaient cette activité que nous modernes appelons « travail », les individus qui travaillent pourraient avoir plus de loisirs (skholé) donc s’adonner en êtres libres à d’autres activités, plus conformes à la nature humaine. Conditions pour méditer et contempler, pour penser le monde, imaginer et réaliser ses œuvres ou s’occuper du bien commun. C’est d’ailleurs pourquoi Aristote dans Les Economiques, pense qu’il serait sage de laisser aux esclaves l’espoir de la liberté « comme prix de leurs peines », et même de les éduquer avec cet objectif.
Il admet qu’il puisse arriver à un individu libre de travailler, il a en face de lui le cas de certains êtres libres qui travaillent pour les artisans, mais il précise dans La Politique que cela ne peut être qu’occasionnel dans la mesure où l’individu durant ce temps ne s’appartient plus lui-même et perd donc dans cette fonction durant le temps de travail où il se vend comme travailleur, sa nature d’humain.. Et d’ailleurs, même occasionnellement, on ne travaillerait que pour ne plus travailler écrit-il dans l’Ethique à Nicomaque. Car la finalité de l’activité du travail, pour un être humain, n’est pas de travailler mais de se réaliser.
Ce n’est donc pas le travail qui rend libre mais le loisir. Et pour ceux qui travaillent, l’individu reprend son humanité quand il se met en congés ou « en retrait » du travail. Alors arrive le temps qui permettrait d’œuvrer, de créer.
Ce rêve d’Aristote, les Temps contemporains l’ont tout autant.
Le robot intelligent, auxquels certains donnent une forme hominoïde, est symptomatique de ce qui se joue.
Le terme « robot » a été inventé par l’écrivain Karel Čapek, en 1920, dans sa pièce Rossumovi Univerzální Roboti. Il désignait des machines humanoïdes produites dans une usine qui travaillent à la place des humains.
L’origine étymologique du mot est révélatrice.
Karel Čapek a forgé le terme à partir du mot « robota (работа) » qui signifie « travail » ou « corvée » en tchèque. Autrement dit, le « robot » est une machine qui remplace l’humain dans l’activité appelée « travail », une activité pénible et d’asservissement (« corvée »).
Ainsi nous voilà par ces robots de l’intelligence artificielle qui remplacent l’humain dans le travail, au cœur du vrai débat : les Temps contemporains construisent-ils un monde où le travail et sa retraite deviendront un jour un souvenir ? La fameuse malédiction de l’humain condamné au travail, portée jusqu’à nous depuis le néolithique par l’esprit magico-religieux, va-t-elle montrer sa vacuité ?
Le travail : malédiction humaine ?
Cette relation entre asservissement, pénibilité et travail humain, portée par le terme tchèque robota (работа) se retrouve en vérité dans toutes les langues slaves, du bulgare au russe. Il est dérivé d’un même terme, venu du lointain proto-slave, langue née vers le ixe siècle av. J.-C. : « orbota ». « Orbota », devenu « robota « en tchèque ou encore « rabota » en russe, par l’inversion du « r » et du « o » due à l’usage de la langue. Or, déjà dans le proto-slave, « orbota » signifie tout à la fois travail et asservissement. Si nous nous amusons à remonter plus loin encore le cours de l’histoire, « orbota » apparaît lui-même dérivé de l’indo-européen « orbh », qui signifie « travail », « jeune esclave » et « orphelin ».
Cette servitude se lit aussi dans les langues latines.
En français ancien, dans la Chanson de Roland (1080), travailler (« travaillent ») apparaît une fois et veut dire « épuiser », « venir à bout de quelqu’un par la fatigue». Les poèmes Li Romans de Carité et Miserere, écrits au xiie siècle par Barthélémy, moine de Molliens-au-Bois, emploient « travaillier » pour signifier « tourmenter », « molester ». En 1160, l’adjectif « travaillos » signifie « pénible ». D’où, plus tard, le mot « traveaul », qui désigne la poutre, celle qui porte le fardeau du toit.
L’origine latine du mot « travail » renvoie-t-elle au « tripalium », instrument d’immobilisation et de torture à trois pieux par lequel esclaves, criminels et opposants étaient mis en croix à Rome ? Pas certain mais la relation reste établie entre travail, pénibilité et, souvent, asservissement. Quand il s’appelle « labor, laboris », quand bien même il est celui d’un général, le travail est associé à la peine. Le monde du travail est distingué du monde de l’opus qui dit l’« œuvre ». Un aristocrate romain ne « travaille » pas, sinon par obligation, il « œuvre», il guerroie, il s’occupe des affaires de la Cité, il médite ou il s’amuse.
Sans en être certain, il me semble que ce triptyque travail-pénibilité-asservissement doit se trouver dans toutes les langues. Ainsi, en chinois, le travail est dit 工作 (gōngzuò). Il se compose des caractères, 工 (gong) et 作 (zuo). Or工 (gong) se rapporte non seulement au succès mais aussi à l’idée de devoir et d’autorité. Il s’agit donc bien d’une obligation et non d’un acte libre. Cette soumission à l’autorité se justifierait pour assurer non le bien de l’individu mais celui de la collectivité. Ce qui connoterait une sorte de sacrifice individuel.
Cette présence du triptyque dans la plupart des civilisations semble confirmé par les grandes mythologies.
Ecoutons le plus vieux mythes connus quant à la naissance d’une humanité condamnée au travail, celle des Sumériens, qui vivaient en le Tigre et l’Euphrate au IVe millénaire avant J.-C, et qui ont inventé l’écriture.
Il était une fois une déesse-mère, Nammu. Elle aimait passionnément les humains et les protégeait de toutes les menaces de la nature. Bercés par cette bienfaisante déesse, tout leur était offert sans efforts. Hélas !, un jour, les dieux Anunnaki, conduits par le dieu Enlil, entrèrent en guerre contre Nammu et ils l’emportèrent. Après leur victoire, l’avenir des humains est sombre. Ces ex-favoris délaissés, dépourvus de tout ce qui permet aux autres animaux de survivre, sont condamnés à mourir de froid, de faim, de soif, de maladies… L’humanité va-t-elle disparaître ?
Survient alors un événement inattendu, les dieux inférieurs, les Igigi, esclaves des Anunnaki, condamnés au travail pour pourvoir à leurs besoins matériels, se révoltent, type grève générale. Ils crient à l’injustice. Le nouveau roi des dieux, Enlil, s’apprête à détruire les contestataires quand Enki, dieu des arts, a une idée lumineuse : conservons les humains pour remplacer les Igigi, dit-il. Condamnons les au travail. Ils cultiveront la terre, élèveront le bétail, commerceront, rapporteront les offrandes, y compris humaines, dont nous sommes si friands. Et voilà nos humains éternellement condamnés à travailler servilement et avec souffrance au service des dieux.
On retrouve une même condamnation dans la plupart des civilisations comme si un fil rouge invisible les tenait toutes depuis le néolithique. Ainsi, dans l’hindouisme, nous rencontrons cette histoire d’une chute de l’humain après la sortie de l’âge d’or, le « Satya Yuga ». On trouve cette même idée d’un paradis perdu en Egypte (le champs de roseaux de Ré), en Iran (le verger de Jima), en Chine (sous le souverain He-son), contes scandinaves et légendes…
En Grèce, lointain berceau de la pensée moderne industrielle, la condamnation de l’humanité au travail adviendrait après l’« âge d’or » décrit par le poète Hésiode, au viiie siècle avant J.-C., qui rapportait la mémoire des Âges des Métaux… Une fois le dieu Chronos vaincu par Zeus, ses ex-favoris, les humains, sont détestés par le nouveau maître de l’Olympe. Ils doivent leur salut au vol du feu par Prométhée. Ainsi peuvent-ils survivre et rivaliser avec les autres vivants par le travail. Mais s’ils sont sauvés, c’est à la façon de Prométhée, soumis et enchainé sur un rocher, souffrant pour avoir désobéi.
Cet esprit magico-religieux venu des plus lointaines sédentarisations a même parfois envahi les spiritualités monothéistes qui ont parfois interprété littéralement la sortie du « jardin d’Éden » de la Genèse comme une punition éternelle au travail et à la peine au lieu de la penser dans la continuité de l’appel à transformer le monde et à la soumettre, et, pour cela, à organiser les moyens de cette transformation.
Ainsi, la tradition, a-t-elle porter ce message de fatalité du travail jusqu’au cœur de la modernité. Non sans incohérence, puisqu’à l’évidence, comme le notait Aristote, tous les humains ne sont pas contraints au « travail », même si certains feignent de confondre par ce mot l’activité de l’esclave et celle du maître qui réfléchit sur son rocking-chair au nombre de coups de fouet nécessaires à lui donner pour accélérer la production. Et puisque « congés » et « retraite » indiquent le désir des humains qui travaillent à quitter ce statut de moyen de production pour vaquer librement à leur occupation. Un désir si fort qu’il fut souvent imposé par la violence.
« Retraite » : lutte pour la reconnaissance de soi et limites
C’est précisément parce que le travail est pour le plus grand nombre globalement pénible et aliénant, transformant l’humain en moyen de production et non en individu réalisant sa liberté, que la question du « retrait » du monde des moyens de travail, fut un progrès. Et, pour la même raison, celle des « congés », de l’ancien français du Xème siècle « cumgiet »,qui dit « l’autorisation de s’en aller ». Il s’agit bien dans les deux cas d’une sortie du processus du travail, l’une momentanée, l’autre définitive. Un progrès qui signale en même temps ses limites existentielles.
Certes, imposer la retraite et les congés, avancée de la justice sociale, fut un progrès réel, difficile à imposer.
D’une part, on se heurtait à un imaginaire structuré depuis le néolithique qui associait travail et nécessité. Pourquoi alors arrêter de travailler ? Imaginaire transformé par la modernité qui ajouta l’idée que le travail devait être célébré comme bienfait pour l’épanouissement individuel, jusqu’à être conçu chez un Baudelaire comme supérieur au loisir et seul moyen pour combattre l’ennui. Il n’est pas anodin que cet adage de la modernité, « le travail rend libre », fut gravé à l’entrée des camps nazis qui, poussaient la modernité au paroxysme comme le nota Hannah Arendt.
D’autre part, on se heurtait aux classes dirigeantes qui profitaient du travail humain. Car cette prétendue malédiction universelle de 12 000 ans a concerné inégalement les individus selon leur place sociale. Tout le monde n’était pas condamné au travail et, parmi ceux qui l’étaient, il existait aussi de grandes disparités.
La « retraite » c(1883 en Allemagne, 1945 en France..) consacre tardivement tout à la fois une victoire humaine contre la structure de l’imaginaire dominant les siècles, mais aussi politique et sociale contre ceux qui trouvaient mille justifications pour voir des humains transformés en moyens de production et contribuer ainsi à assurer leur propre richesse
Il n’est pas anodin que l’esclave ne prenne pas de « retraite ». Il reste jusqu’à la mort l’outil de son maître. Le serf quant à lui reste attaché à sa terre et doit servir jusqu’à son trépas le seigneur via corvées et autres obligations.
Le salarié affirme, lui, dans ce « retrait » du travail, sa vraie nature humaine, d’individu né libre. Parvenu à la conscience de lui-même, il exige de pouvoir sortir à un moment de sa vie du processus de travail, d’en prendre un congés occasionnel ou de se mettre « en retrait » au crépuscule de sa vie. Ainsi, affirme-t-il la certitude d’être existentiellement autre chose qu’un outil dans un procès de travail.
Cette sortie de l’aliénation de lui-même comme moyen de production est un progrès moral indéniable mais les limites de la « retraite » apparaissent pourtant à la réflexion.
Le nom de « retraite » l’indique: cette position est négative. Si la retraite est posée comme « retrait » des modes de transformation du monde, comme repos éloigné des moyens du travail, comment offrir au retraité les moyens de libérer son énergie, et donc de parvenir à la pleine reconnaissance de soi dans la production d’une œuvre, aussi modeste soit-elle? Il faut bien pour cela n’être pas « en retrait » ou « en congés » des modes de production.
En termes de reconnaissance de soi, la formidable imagination des retraités pour tenter de régler cette question en s’activant, en trouvant mille façons d’être eux-mêmes dans la durée libre de cette partie de leur vie qui leur appartient, compense difficilement ce qui est souvent perçu par le regard des autres comme une mise à l’écart.
Une question redoublée par le « moment » de la retraite : 60, 62 64, 65 ans ? Certes, la question est d’importance pour chacun mais ces datations ont peu à voir avec la vraie temporalité de la vie qui est, comme le disait Henri Bergson, la durée.
La retraite vient sur le tard, toujours trop tard, après la perte irrémédiable d’une partie de sa propre vie qui a été aliénée dans le monde de la production, comme moyen. Ainsi, la durée individuelle de la vie et son intensité ont-elles été, pour le plus grand nombre, en grande partie englouties dans la temporalité sociale de la production, son rythme et ses obligations.
Le salarié devient seulement dans ses congés ou au crépuscule de sa vie, l’aristocrate de sa vie, celui qu’il aurait pu être si la naissance, le hasard, ou le développement des sciences et des technologies, auquel rêvait un Aristote, l’avaient permis.
Cette impossibilité d’être celui qu’il aurait dû être, ne vient pas seulement, ni même essentiellement, des rapports de domination réels dans la Cité. Le « travail » humain est d’abord la marque d’une humanité sous-développée qui ne pouvait se passer des moyens humains de production pour survivre et se développer. En ce sens il est bel et bien la conséquence d’une impuissance, transformée par l’esprit magico-religieux en malédiction.
C’est avec cela que rompt la révolution des Temps contemporains.