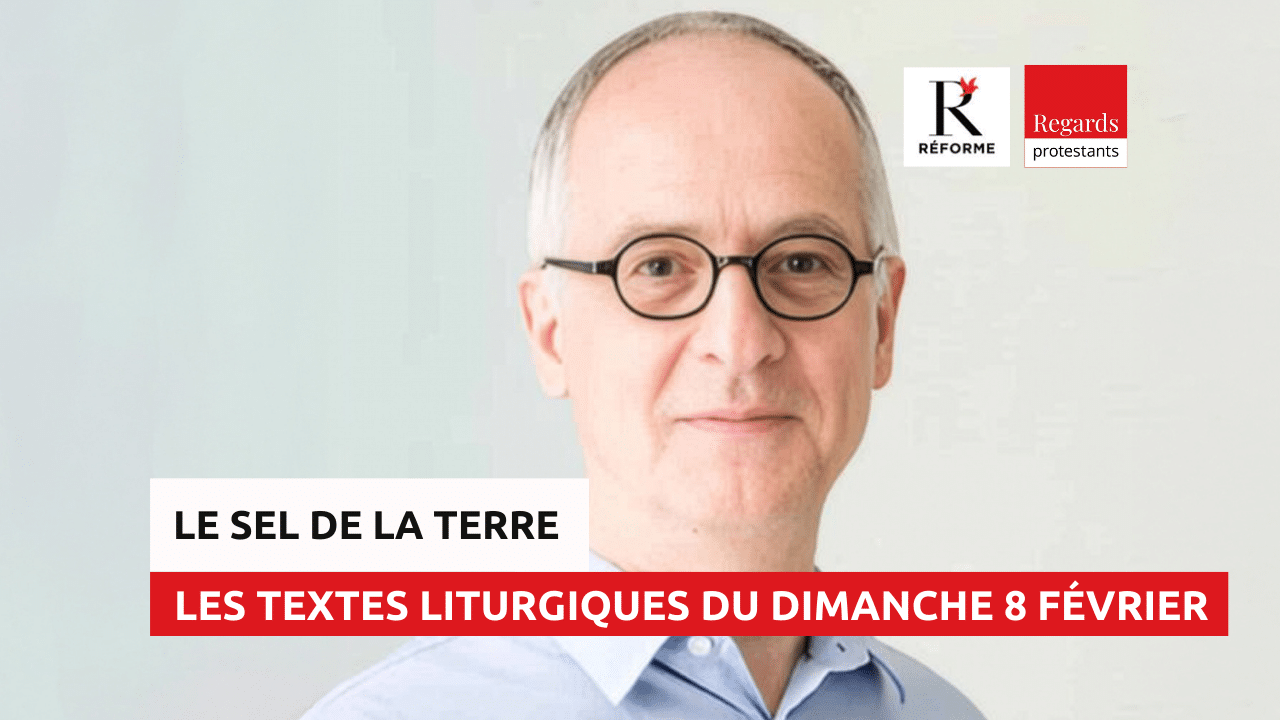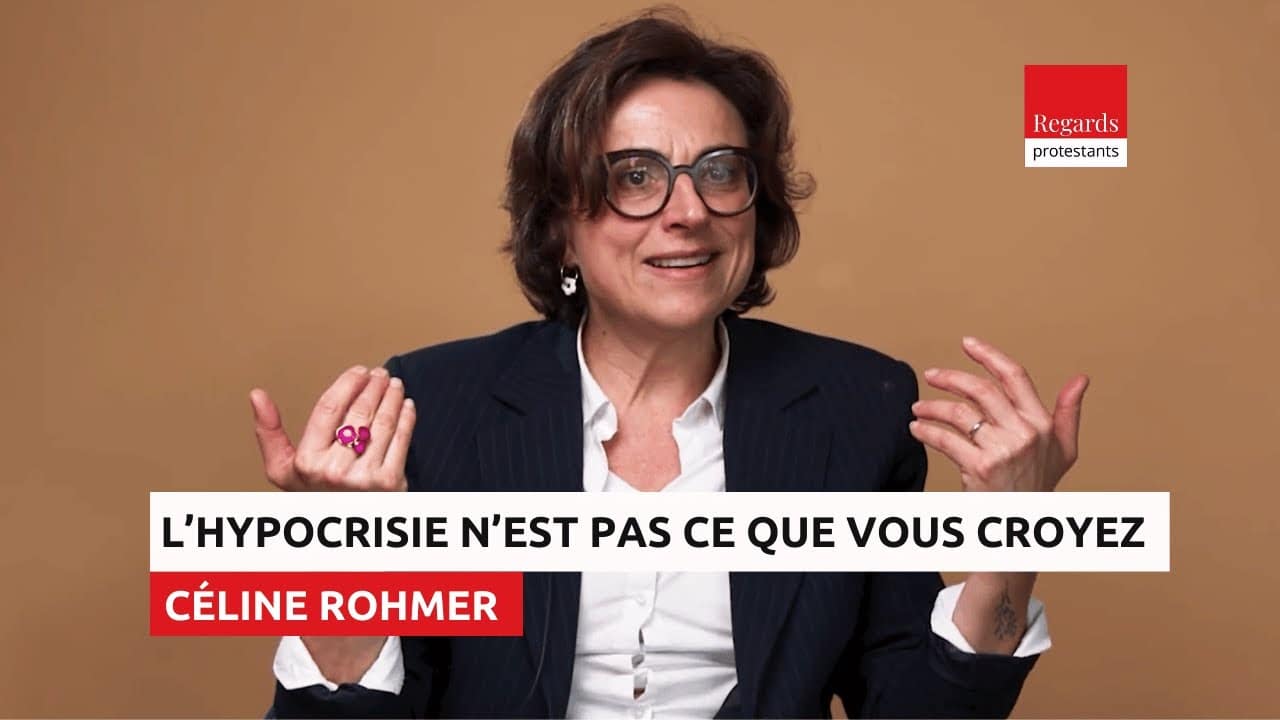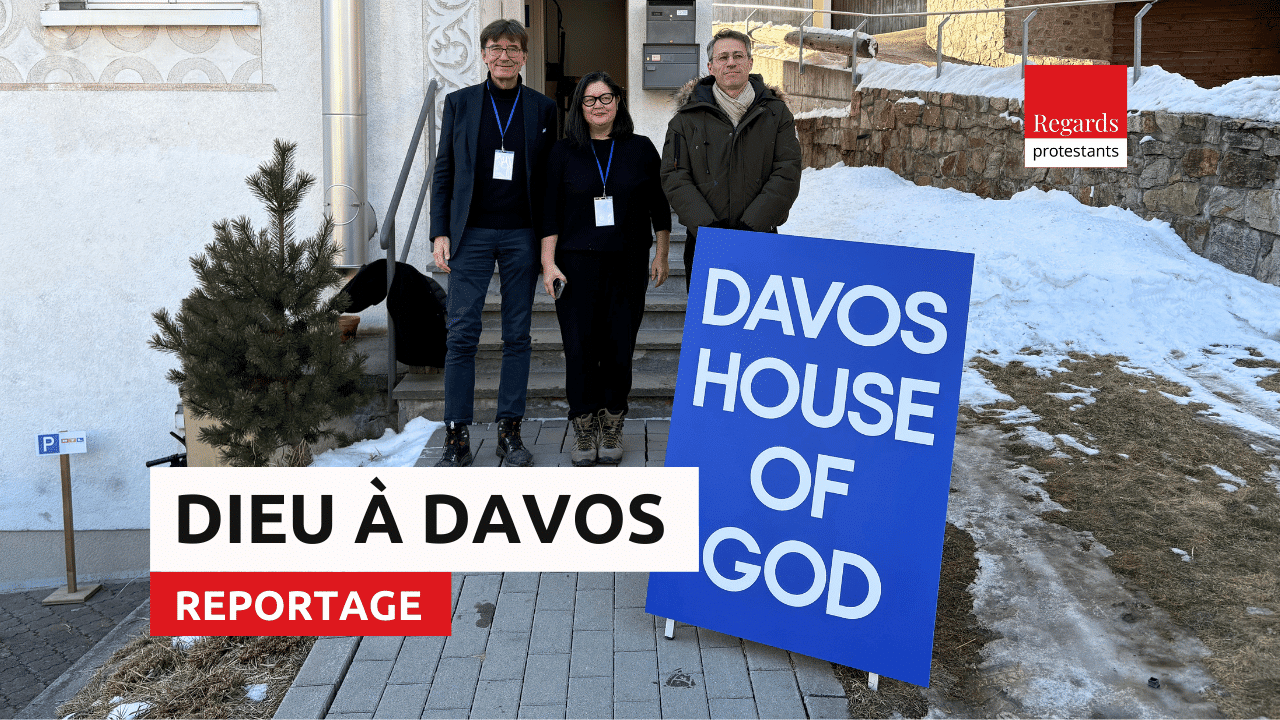L’évangile de Luc du 20 avril (Luc 24, 13-35)
Jésus chemine avec ses disciples
Introduction
Le récit des pèlerins d’Emmaüs est propre à Luc. Chaque évangile a un récit de l’apparition du ressuscité. Chez Matthieu, Jésus retrouve ses disciples en Galilée pour les envoyer en mission dans le monde entier, Marc se termine sur la peur des femmes devant l’annonce du tombeau vide, Jean évoque une première Pentecôte puis il raconte comme le ressuscité a retrouvé ses disciples sur la rive d’une pêche infructueuse, et Luc nous rapporte la rencontre avec deux disciples dans leur marche vers Emmaüs.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Les disciples en deuil
Les pèlerins s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. En suivant Jésus, ils avaient espéré que Jésus était celui qui devait apporter la rédemption à Israël comme ils le diront, mais ils se sont trompés, celui qu’ils avaient suivi a été broyé par les forces d’oppression.
On imagine leur déception, ils sont en deuil de leur maître, en deuil de leur foi et de leur espérance. Ils en parlent entre eux pour mettre des mots sur leurs maux, ils ont besoin de parler pour dire leur déception.
Jésus fit route avec eux.
Pendant qu’ils s’entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux. Le verbe s’approcher évoque une certaine délicatesse. Jésus ne s’impose pas, il s’approche avec précaution de ceux qui sont en chemin pour faire route avec eux.
Plus tard, ils diront : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? La foi est la démarche qui consiste à entendre que le Christ marche à nos côtés et qu’il nous aide à donner du sens aux événements de notre vie.
Pistes d’actualisation
1er thème : Ils étaient empêchés de le reconnaître
Il est étonnant que les disciples n’aient pas reconnu celui dont ils étaient en train de parler. D’autant que la rencontre n’est pas fugitive, elle a duré deux heures. En outre, Jésus adopte la position d’un maître qui enseigne.
Ce verset évoque une expérience de tous les temps. Pour certaines personnes, l’évangile est une évidence, alors que pour d’autres, on a le sentiment qu’ils ont un voile qui cache ce qu’ils ont devant eux. La foi ne consiste-t-elle pas tout simplement à voir ce que nous avons devant les yeux ? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul dit que nous avons un voile devant les yeux qui ne disparaît que dans le Christ (2 Co 3.14). C’est l’expérience que font les pèlerins dans ce récit quand ils reconnaîtront que celui qui marche à leurs côtés est celui qu’ils pensaient mort.
2e thème : La pédagogie de Jésus
Lorsque Jésus rejoint les pèlerins, il ne s’impose pas, en bon pédagogue, il commence par faire parler ses interlocuteurs pour les conduire à découvrir eux-mêmes qui il est. Il leur donne l’occasion de formuler leur déception, puis il leur répond en utilisant les Écritures comme un tiers entre eux et lui : Commençant par Moïse et par tous les Prophètes, il leur fit l’interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Après avoir parlé, quand ils sont arrivés au terme de leur voyage, Jésus les laisse en faisant semblant de poursuivre son chemin.
Jésus ne s’impose, il les accompagne dans leur cheminement qui les conduira à le reconnaître dans le signe de la fraction du pain. Dès qu’ils l’ont reconnu, il disparaît. Ils auraient sûrement désiré que Jésus reste avec eux, mais maintenant qu’il leur a apporté ce qu’ils cherchaient – un sens à leur histoire –ils les laissent pour qu’ils prennent leur responsabilité de témoin.
Si je peux ajouter une parenthèse, je suis frustré que Luc ne nous en dise pas plus sur les textes cités par Jésus pour dire ce qui le concernait. Ça nous aurait aidé à découvrir l’herméneutique de Jésus.
3e thème : Ils le reconnurent à la fraction du pain
C’est le signe du pain et la parole de bénédiction qui leur ont ouvert les yeux afin qu’ils accèdent à l’évidence de ce qui est devant eux.
Il prit le pain et prononça la bénédiction ; puis il le rompit et le leur donna, ces quatre verbes se retrouvent dans le récit de la multiplication des pains (Lc 9.16) et, à une nuance près, dans l’institution de la cène (Lc 22.19). C’est dans le pain béni, rompu et donné que les pèlerins vont enfin voir ce qu’ils ont devant les yeux. Ils n’ont probablement pas participé au dernier repas de Jésus, mais ils ont vu Jésus présider des repas. Ce dernier devait avoir une façon particulière de prononcer la bénédiction et de rompre le pain pour qu’il se fasse reconnaître dans ce geste. Ces deux moments qualifient la foi : Dire la bénédiction, rendre grâce pour le moindre morceau de pain ; et partager le pain, devenir compagnon selon l’étymologie du mot (celui avec qui on partage le pain).
Une illustration : Le besoin du frère
Ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Dans l’anthropologie biblique, le cœur est le lieu du raisonnement et de l’intelligence. Lorsque les disciples disent que leur cœur brûle, ils évoquent une nouvelle intelligence des Écritures, donc de leur compréhension du divin.
Au début du récit, ils se disent l’un à l’autre leur déception, à la fin ils se disent ce qu’ils ont vécu. C’est en se parlant que les disciples comprennent le sens de ce qu’ils ont vécu.
Un apophtegme des pères du désert raconte qu’un frère butait sur un passage des Écritures qu’il ne comprenait pas. Il a pris la décision de jeûner pendant six mois, en ne prenant que trois repas par semaine pour que Dieu lui révèle l’interprétation du passage, mais ce dernier restait silencieux. Alors, il s’est dit : « je vais aller trouver un frère pour qu’il m’éclaire. » Pendant qu’il était en route, Dieu lui adressa la parole et lui dit : « Maintenant que tu as été assez humble pour te mettre en route à la rencontre de ton frère, je vais te donner l’explication que tu cherchais. »
Le texte de la lettre aux Colossiens du 20 avril (Colossiens 3.1-4)
Vivre en ressuscité
Le contexte – L’épître aux Colossiens
L’authenticité paulinienne de l’épître aux Colossiens est discutée, même si on trouve en son sein plusieurs thèmes typiquement pauliniens, dont l’affirmation de notre justice devant Dieu par le Christ qu’il annonce par une formule ramassée et percutante : le Christ vous a maintenant réconciliés, par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche.
La raison qui a conduit à la rédaction de cette épître est un danger qui menace l’Église. Certaines personnes, dont nous ignorons tout, appellent les Colossiens à mener une vie ascétique au nom d’une sagesse supérieure. Paul a des propos très durs pour ses personnes en disant que, sous un couvert d’humilité et de culte des anges, ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair. Cela le conduit à un vibrant plaidoyer en faveur de la liberté chrétienne : Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales : « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas… »
Dans le passage de ce dimanche, après avoir affirmé que le disciple est mort avec le Christ, il ajoute qu’il est ressuscité avec lui : vous êtes réveillés avec le Christ.
Que dit le texte ? – Votre vie est cachée en Dieu
Mort avec le Christ et ressuscité avec le Christ, le disciple n’a plus besoin de vivre selon les règlements de notre monde mais à chercher les choses d’en haut. Avant d’arriver à cette affirmation magnifique : Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Dans la foi, il y a une dimension intime. Mon identité profonde, mes peurs et ma liberté, mes souffrances et ma prière, mes désirs et mon espérance ne sont pas publics, ils sont cachés en Christ.
Dans nos relations sociales, nous exposons la surface de notre personne. Devant Christ, nous pouvons être en vérité, avec ce qu’il y a de plus caché en nous. C’est ce que dit Jésus à propos de la prière : Quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra (Mt 6.6).
C’est dans le secret, le caché, que se joue l’essentiel et la respiration de la foi. Ce qui est public n’est que la face émergée de l’iceberg.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le tombeau vide
Lors de la résurrection, le passage de l’évangile dit que jusqu’à l’expérience du tombeau vide, les disciples n’avaient pas encore compris l’Écriture, selon laquelle il devait se relever d’entre les morts. Jésus avait annoncé publiquement sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises, mais les disciples n’avaient pas imprimé l’information. À partir du moment où ils ont vécu l’expérience du tombeau vide, ils ont été habités par l’espérance de la résurrection et rien ne les a empêchés d’en témoigner.
Il y a la foi qui reste à la surface de notre personne et la foi qui vient du fond de notre personne, de ce lieu intime, caché. C’est de là que nous devons vivre et que nous pouvons partager l’Évangile.
Le texte des Actes des apôtres du 20 avril (Actes 10.34-43)
La confession de foi de Pierre
Le contexte – Les Actes des Apôtres
Le livre des Actes des Apôtres raconte l’histoire de la toute première Église. Très vite une question qu’elle a dû affronter est de savoir ce qu’elle était le positionnement théologique de l’Église. Est-ce qu’elle se considère comme une branche du judaïsme, ou est-elle appelée à dépasser les limites du judaïsme ?
Dans un premier temps, comme tous les apôtres étaient juifs et qu’ils pensaient que le Christ allait revenir de façon imminente, c’est la première position qui s’est imposée, mais l’Esprit les a conduits à comprendre qu’ils étaient appelés à s’ouvrir sur l’universel. Le récit qui marque la charnière vers cette nouvelle position est celui de la venue de Pierre chez Corneille. L’Esprit a multiplié les signes pour accompagner cette évolution en envoyant un ange à Corneille, une vision à Pierre et une interprétation de la vision.
Arrivé chez Corneille, Pierre lui annonce l’Évangile dans une prédication narrative qui retrace la vie de Jésus de Nazareth pour dire qu’il est le Christ qu’ils attendent.
Que dit le texte ? – La prédication de Pierre
Plutôt que de se lancer dans une prédication philosophique sur la messianité de Jésus, Pierre parle de sa vie en soulignant le contraste entre ce qu’il a fait : il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, et la façon dont il a été traité, il a été supprimé en étant pendu au bois. Ce qui pouvait être vu comme une injustice radicale et l’échec d’une vie s’est retournée lorsque Dieu l’a relevé d’entre les morts et qu’il s’est manifesté non à tous, mais aux témoins qui doivent proclamer qu’il est le juge des vivants et des morts.
De ce message, nous pouvons relever trois points.
La vie est injuste : celui qui a fait le plus de bien est celui qui a été le plus cruellement traité.
La mort n’est pas la fin de tout. Nous savons que nous pouvons vivre l’Évangile, par ce que notre vie est plus grande que sa réalité terrestre.
Le relèvement d’entre les morts et la manifestation du Christ aux témoins désignés d’avance sont le commencement d’une nouvelle histoire.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le tombeau vide
La résurrection n’est pas le super-miracle destiné aux chefs des juifs et aux Romains qui ont crucifié Jésus pour leur montrer qu’il est plus fort que la mort, elle commence par un tombeau vide, c’est-à-dire une absence. Mais ce rien est le signe que la mort a été vaincue. La résurrection est une bonne nouvelle adressée à tous les humains et une puissance de vie pour les disciples.
C’est nous aujourd’hui qui avons mis foi en la résurrection qui sommes appelés à proclamer au peuple que le Christ est vivant et qu’il nous apporte le pardon.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : Antoine Nouis